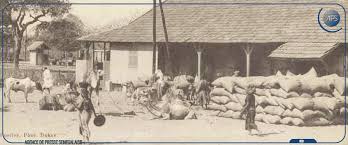Au Sénégal, le respect de la parole donnée, autrefois pilier des sociétés traditionnelles, est aujourd’hui remis en question. L’Agence de Presse Sénégalaise (APS) s’est penchée sur ce déclin, notamment dans le contexte actuel de communication intense et de forte présence médiatique.
La parole, un engagement sacré dans les sociétés précoloniales
Babacar Wade, enseignant de philosophie à Thiès, souligne le contraste entre le passé et le présent : « Aujourd’hui, on parle trop et on agit peu. On oublie qu’ici, la parole liait autant que la mort ». Dans le royaume wolof du Kajoor, la parole publique, le « wax », avait une valeur juridique et sociale. Le Damel, souverain du royaume, devait incarner la fiabilité de sa parole, perçue comme un engagement sacré.
L’adage wolof « Sa wax ngay jëfe », signifiant « ta parole te précède dans l’action », témoigne de l’importance de la parole dans la tradition sénégalaise. Une promesse non tenue était considérée comme une trahison, entraînant une exclusion sociale. Perdre son « ngor », sa dignité, était la conséquence d’un engagement verbal non respecté.
Le rôle central des griots, gardiens de la mémoire
Les griots, « gewel », jouaient un rôle essentiel dans la préservation de la parole donnée. Généalogistes, chroniqueurs et juristes coutumiers, ils garantissaient la mémoire des engagements pris. L’historien Atoumane Ndiaye rappelle leur influence : « La parole du griot pouvait élever un Damel ou précipiter sa chute ».
Ils pouvaient rappeler à l’ordre les chefs oublieux de leurs promesses et dénoncer publiquement les manquements. Leur rôle dépassait le divertissement, touchant au cœur de la légitimité politique et morale.
La parole, un code éthique transversal
Ce respect de la parole n’était pas limité au Kajoor. En Casamance, la parole prononcée lors de l’initiation liait les jeunes à vie. Moussa Sagna, enseignant et ancien initié d’Oussouye, explique : « Après l’initiation, ce qu’un homme dit devient loi pour lui. Le verbe lie l’âme ».
Chez les Peuls du Fouta, la parole d’engagement, le « ndem », était enregistrée dans la mémoire collective. Chez les Sérères du Sine et du Saloum, l’initiation « ndut » enseignait que la parole était sacrée et pouvait, si elle était mal utilisée, briser des lignées.
La crise de confiance actuelle
Le « kàddu bu wër », le vrai et juste mot, était la base de la justice coutumière. Mentir en public était source de honte. Aujourd’hui, la parole semble s’être détachée de l’action, perdant son ancrage éthique. Le sociologue Ibrahima Sow met en garde : « Quand le Premier ministre dit que la parole de l’État vaut engagement, il faut qu’il en donne la preuve. Sinon, ce sera juste un mot de plus dans la mer des promesses non tenues ».
Ramatoulaye Diallo, juriste à Thiès, plaide pour une refondation morale de la parole publique : « Parler, ce n’est pas séduire. C’est s’engager. Dans nos traditions, le verbe était action, vérité et honneur ».